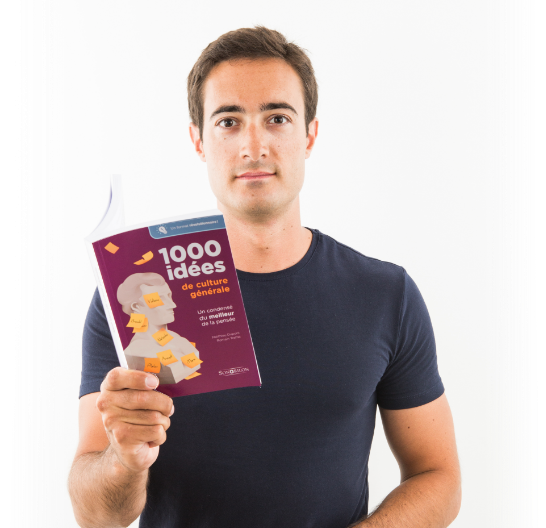L’opium des intellectuels dénonce l’emprise du marxisme sur les penseurs. À l’époque où une majorité de ceux-ci manifestent leur sympathie à l’égard du parti communiste, Raymond Aron affirme dans L’opium des intellectuels qu’ils adhèrent en réalité à une philosophie totalitaire. Cette situation montre plus généralement que l’intelligence et la culture n’empêchent pas le fanatisme.
L’opium des intellectuels repose sur des mythes politiques. Raymond Aron en dénombre précisément trois : la gauche, la révolution et le prolétariat. « Cherchant à expliquer l’attitude des intellectuels, écrit-il, impitoyables aux défaillances des démocraties, indulgents aux plus grands crimes, pourvu qu’ils soient commis au nom des bonnes doctrines, je rencontrai d’abord les mots sacrés : gauche, Révolution, prolétariat » (L’opium des intellectuels). La gauche, tout d’abord, constitue un mythe pour le philosophe dans la mesure où elle n’a jamais constitué un courant politique véritablement uni. Elle oppose en effet une gauche libérale, une gauche organisatrice plus ou moins autoritaire, et une gauche égalitaire. Le deuxième mythe attaqué par Raymond Aron est celui de la révolution, dont il précise qu’elle est un coup d’État si elle n’est pas de gauche. Contrairement à la théorie, la révolution marxiste ne peut pas être libératrice ni amener la fin de l’Histoire, parce qu’elle consiste en pratique en la substitution violente d’une élite à une autre. Elle n’est en réalité qu’un concept exprimant la nostalgie d’un idéal, un âge d’or mythologique (qui n’a donc jamais existé). Enfin, le dernier mythe faisant l’opium des intellectuels est celui du prolétariat. Pour Raymond Aron, les contours de cette classe sont extrêmement vagues et elle n’est pas homogène – il existe un écart important entre le prolétariat réel et celui conçu par Marx.
La conscience de classe selon Marx
Raymond Aron voit l’opium des intellectuels comme une religion
L’opium des intellectuels comporte la foi en un sens de l’Histoire. Alors qu’il est empreint de préjugés faciles sur l’inéluctable déclin du capitalisme, le marxisme est considéré comme une théorie vraie par beaucoup d’intellectuels de gauche de l’époque de Raymond Aron, comme Maurice Merleau-Ponty ou Jean-Paul Sartre. Le problème profond de cette croyance est qu’elle rompt totalement avec la rigueur de l’historien professionnel : elle interprète le passé comme bon lui semble et prétend connaître l’avenir en vertu d’une loi universelle et infaillible, alors que l’historien se limite, dans sa modestie scientifique et en toute légitimité, à rendre l’Histoire intelligible. En fait, la diversité des significations pouvant être tirées des événements interdit de réduire, comme le fait le marxisme, la complexité du monde à un sens unique. Pour Raymond Aron, la reconstitution historique demeure forcément inachevée. Le philosophe en déduit que « les philosophies de l’histoire sont la sécularisation des théologies » (L’opium des intellectuels), c’est pourquoi elles ne prennent pas en compte la contingence à l’œuvre dans l’Histoire qui empêche toute prédiction. Ainsi, rien ne permet de prévoir le destin du capitalisme, si ce système va s’autodétruire, engendrer des conflits, ou au contraire prospérer. Le sens de l’Histoire est donc le totalitarisme d’une raison fantasmée qui autorise tous les crimes pour conformer le chaos historique à quelques principes simples d’explication.
Les chiens de garde selon Paul Nizan
L’opium des intellectuels révèle leur aliénation fondamentale. Raymond Aron développe cette affirmation en comparant le marxisme à une religion. En effet, cette idéologie présente le prolétariat, cette classe élue, comme le sauveur collectif de l’humanité. Ce prophétisme moderne fait du marxisme une religion séculière née sur les décombres du christianisme. « La mort de Dieu laisse un vide dans l’âme humaine, explique Raymond Aron, les besoins du cœur subsistent qu’un nouveau christianisme devra satisfaire. Seuls les intellectuels sont capables d’inventer, peut-être même de prêcher, un substitut des dogmes anciens qui soit acceptable aux savants » (L’opium des intellectuels). Dès lors, l’emprise du marxisme sur les esprits apparaît comme une tentative politique de substituer une idéologie à la religion. Or, cette substitution est spécifique à la France, où les intellectuels prétendent parler au nom de l’humanité entière, quand les Britanniques et les Américains sont beaucoup plus pragmatiques. Raymond Aron dénonce l’éminente hypocrisie de cette attitude : les intellectuels français excitent les passions qui divisent la société et prônent la révolution dans le confort et la liberté d’une société capitaliste libérale. Ils font par exemple preuve d’un antiaméricanisme virulent – comme en témoigne l’article de Sartre sur l’affaire des espions communistes Rosenberg – tout en se montrant indulgents avec les crimes de l’URSS. La mission de l’intellectuel devrait au contraire être d’apaiser les passions en promouvant les valeurs humaines abstraites et universelles comme la vérité ou la justice.